![]()
« Nous devons développer une culture de l’eau »
Esther Crauser-Delbourg, du cabinet de conseil Water Wiser, nous explique pourquoi l’eau est essentielle à la préservation des écosystèmes.
Comment vous êtes-vous intéressée à l’eau ?
Durant mes études, j’ai réalisé que l’eau était un sujet majeur à la fois pour l’économie, la géopolitique et la survie de nos écosystèmes. Un chiffre m’a marquée : 90 % de l’eau que nous utilisons ne nous sert pas à nous laver ou à boire, elle va aux productions agricoles, industrielles et énergétiques. La crise de l’eau liée au dérèglement climatique risque donc d’affecter, voire de bloquer, l’économie. Depuis 2022, le sujet est devenu majeur en France et en Europe, à cause de la canicule. Des installations industrielles ont dû fermer, on a eu des tensions sociétales. J’ai créé le cabinet de conseil Water Wiser pour accompagner les grands groupes dans ces enjeux.
L’eau est-elle un bien commun ou un bien économique ?
Les deux ! Il y a plusieurs façons de voir l’eau. Bien sûr, c’est une ressource vitale pour l’homme et la nature. Elle représente aussi une menace, quand il y en a trop, ou pas assez. C’est également un moyen de transport et une ressource indispensable à la production, nous venons de l’évoquer. Donc, sans eau, tout s’effondre. Or, nous l’utilisons souvent de façon sous‑optimisée, sans mesurer ce que nous faisons, sans tenir compte des cycles naturels. Par exemple, nous produisons des biens très consommateurs en eau dans des lieux où cette ressource manque et où elle n’est pas toujours dépolluée : 80 % de l’eau utilisée dans l’industrie et l’agriculture est rejetée sans être traitée. Cela, dans un contexte où le changement climatique opère une forme de redistribution de l’eau sur la planète qui est encore plus inégale qu’auparavant.
Le partage de la ressource occasionne des tensions sociétales. Comment les apaiser ?
Quand il fait chaud, tout le monde a besoin de beaucoup d’eau en même temps, ce qui crée des tensions. Par exemple en été, les campings, les hôpitaux ou les agriculteurs sollicitent les cours d’eau ou les nappes phréatiques, ce qui peut impacter le débit des rivières et peut, à terme, affecter la capacité de refroidissement des centrales nucléaires. Comment faire ? Pour agir, il faut d’abord compter. Compter l’eau nécessaire à la production industrielle, tout comme celle de l’agriculture. Plus de 90 % de l’agriculture repose sur l’eau de pluie. Si on sait la mesurer correctement, on peut mieux anticiper et allouer de l’irrigation si nécessaire. Ce type de démarche peut favoriser le vivre‑ensemble.
Comment encourager les particuliers et les entreprises à agir dans leurs territoires ?
Il faut aller vers la sobriété. On peut vivre et produire avec moins d’eau. Le Plan eau du gouvernement vise une baisse de 10 % des usages domestiques d’ici à 2030. En France, la consommation moyenne est de 150 litres par jour et par personne. Une minute de douche, c’est 15 litres en moyenne. Donc l’objectif semble atteignable. On peut aller plus loin, par exemple en réutilisant des eaux de douche ou de machine à laver pour les toilettes ou le jardin. S’agissant des entreprises, celles‑ci ont encore besoin d’affiner leur vision des choses, car elles n’ont jamais précisément calculé ce que l’eau représentait pour elles, en termes de création de valeur économique. Lorsque nous intervenons auprès des industriels, nous trouvons souvent, en étudiant leur process de production, entre 20 % et 30 % d’économies potentielles.
Quel type de relations nouez-vous avec les porteurs de projet ? Les suivez-vous à long terme ?
Les entrepreneurs qui s’adressent à l’Adie viennent d’abord parce qu’ils ont besoin d’argent. Mais si vous les interrogez quelques années plus tard, ils vous parleront du conseiller ou du bénévole qui les a accompagnés ! Quand on crée une entreprise, en indépendant, on est souvent seul. Certains ont besoin d’être épaulés sur tous les plans : informatique, comptabilité, etc. Notre présence à leurs côtés est un élément fondamental de notre modèle.
Pourquoi ne sommes-nous pas davantage sensibilisés ?
Nous devons développer une culture de l’eau. Nous n’avons jamais bien compté ce que nous consommions, car le prix réel de la ressource est méconnu : on paye les infrastructures mais pas la rareté. Un litre d’eau dans une région sèche coûte, en théorie, au consommateur à peu près autant qu’un litre dans une région où l’eau est abondante. En outre, la crise est récente. Le sujet n’est pas encore à l’agenda international. Et puis, l’eau étant partout, il est difficile de déterminer où doit se situer la gouvernance.
Les Banques Populaires affirment leur ambition de devenir la première banque française en matière de gestion et de préservation de l’eau. Quelles perspectives cela ouvre-t-il ?
C’est du jamais‑vu en France, et c’est crucial. Le fait que les Banques Populaires s’en emparent, cela signifie que les initiatives vont partir du territoire, ce qui est décisif pour l’eau. Et le modèle coopératif est très adapté aux enjeux, car il faut une connaissance fine des acteurs. On a besoin de proximité avec les industriels, les agriculteurs, les énergéticiens et avec tous les utilisateurs. Si une entreprise doit investir dans une captation d’eau pour sa propre production, il y a un accompagnement nouveau à mettre en place, qui ne peut pas se jouer à l’échelle nationale mais locale. Au niveau national, l’engagement des Banques Populaires est un message formidable envoyé aux acteurs économiques et aux pouvoirs publics.
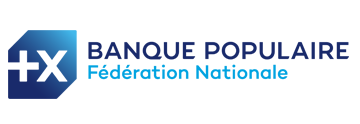






 Les Banques Populaires ont lancé le mouvement Agir pour l’Eau pour accompagner et faciliter la transition hydrique, la gestion et la préservation de l’eau en France, pour les entreprises et les territoires.
Les Banques Populaires ont lancé le mouvement Agir pour l’Eau pour accompagner et faciliter la transition hydrique, la gestion et la préservation de l’eau en France, pour les entreprises et les territoires.



